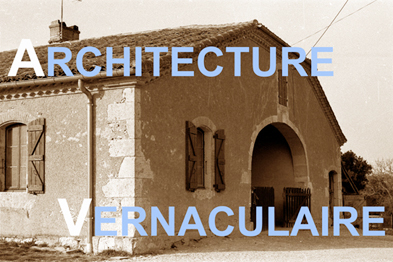L'ÉVOLUTION DE LA CABANE CAMARGUAISE AU XXe SIÈCLE
|
|
|
|
Cabane de pêcheur au « Vieux-Rhône », à la Goule Sainte-Anne (cliché Carle Naudot). |
2 - Fausses cabanes mais vraies maisons de pêcheurs aux Saintes-Maries
Document No 2
Voici une rare carte postale de la première décennie du XXe siècle censée montrer des « cabanes de pêcheurs » camarguaises. Malgré la perte de détail due à la colorisation en vert et jaune, on peut constater qu'il s'agit de véritables maisons et non pas de cabanes :
- le bâtiment de droite a deux pignons rectilignes en dur aux rampants débordants (et non pas un pignon et une abside) ;
- le bâtiment de gauche affiche, à l'avant, un pignon rectiligne, en pierres taillées et assisées, dont les rampants saillent par rapport au chaume.
Le seul trait qui apparente l'un et l'autre bâtiment à la cabane camarguaise à abside est le chaume de sagne recouvrant leur toiture à deux versants.
On remarque que la maisonnette de droite a sa souche de cheminée qui saille à mi-parcours de la ligne de faîte, signe de la présence d'une cloison intérieure. La maisonnette de gauche, quant à elle, a une souche de cheminée qui saille au niveau du pignon arrière, en haut du versant visible.
|
|
|
Carte postale colorisée de la première décennie du XXe siècle. |
Document No 3
Dans cette autre carte postale de la première décennie du XXe siècle, la longère à façade en pignon présente des similitudes avec la maison de gauche de la carte précédente : son pignon est en pierres taillées et assisées et ses rampants sont en saillie par rapport au chaume de la toiture. Celui-ci d'ailleurs semble avoir été recouvert entièrement d'un enduit au plâtre (étanchéité oblige) dont quelques pans ont glissé, découvrant la sagne sous-jacente. Le même enduit se retrouve sur le triangle du pignon et dans sa parte basse (sous forme de plages déliquescentes).
|
|
|
Carte postale noir et blanc non antérieure à 1904 (dos divisé) ; tampon de la poste en date du 19 août 1909. |
Documents Nos 4a, 4b et 4c
Au dos de cette carte postale des années 1930 (bordure blanche), le long du bord inférieur, une main a écrit, à l'encre noire, « Les dernières cabanes de pecheurs aux Saintes Maries de la Mer - Camargue » (nous avons respecté l'orthographe). En fait, des deux bâtisses, seule celle de droite mérite l'appellation de « cabane », celle de gauche étant bel et bien une maison basse avec tous ses murs maçonnés en dur, ses fenêtres en gouttereau.
|
|
|
Carte postale des années 1930 (bordure blanche caractéristique de cette décennie). PHOTO = Il s'agit du photographe Émile Barral d'Arles (Bouches-du-Rhône), éditeur de cartes postales locales dans le premier tiers du XXe siècle. |
Document No 4b : La maison : agrandissement de détail
Certes, certaines caractéristiques ne sont pas sans rappeler la cabane camarguaise de cette époque : la cheminée intérieure adossée contre la moitié gauche du pignon, l'entrée ménagée dans la moitié opposée, la porte extérieure à moustiquaire, la couverture de sagne et la bande d'enduit en haut de chaque versant et sur les rampants. Une petite différence toutefois : il ne semble pas y avoir de rangées de javelles étagées comme sur la cabane proche.

Document No 4c : La cabane : agrandissement de détail
La cabane de sagne, pour sa part, évoque ses consœurs entièrement végétales des cartes postales des années 1900, hormis les modifications apportées au gouttereau de gauche : un mur en dur a en effet été plaqué contre la paroi originelle, entraînant le racourcissement et le relèvement du versant de toiture.
La configuration de l'arrière la cabane est des plus curieuses : il n'y a pas d'abside, le pignon est droit ainsi que l'atteste la position quasi verticale de l'échelle dont on voit le bout dépasser du faîtage, mais la longueur du versant au niveau de la rive est moindre que celle du faîtage. Mystère !
L'examen du pignon trahit la structure porteuse de l'édifice : le décalement de l'entrée sous le rampant de gauche provient de la présence d'un poteau axial porteur derrière la paroi de roseau, poteau qui sert à soutenir la panne faîtière dont le bout pointe sous l'apex. Le pendant de ce poteau doit exister à l'arrière du bâtiment.
Cette petite cabane n'est qu'une annexe de la maison (réserve d'eau douce, remise pour le matériel ?).

Document No 5a
L'explication de l'arrière tronqué de la cabane et de son gouttereau en dur nous est livrée par l'examen d'une carte postale antérieure de 20 ou 30 ans et intitulée « Les chaumes et la Route d'Arles » : on y aperçoit, à l'arrière-plan, la maisonnette et la cabane, cette dernière se trouvant non plus devant la maisonnette mais à côté, en bordure d'un tournant de la route d'Arles. Il y a donc eu déplacement de la cabane, pour une raison qui nous échappe (élargissement de voirie ?).
Le long de la roubine, on observe toute une succession de planches en bois au bout arrondi, s'avançant depuis la rive ravinée et posant sur un caillou dans le lit du cours d'eau. La fonction de cette installation, à l'évidence un lavoir, est confirmée par une carte postale de la même époque (cf. infra), où l'on voit des habitantes des Saintes-Maries à l'œuvre.
|
|
|
Carte postale du début du XXe siècle. |
Document No 5b : agrandissement de détail
Cet agrandissement de détail nous renseigne sur la disposition et l'aspect des bâtiments deux à trois décennies plus tôt. Un auvent rudimentaire précède le pignon de la maisonnette, une ménagère y travaille, à l'abri du vent. À droite de la cabane on aperçoit, en retrait, le pignon d'un autre édicule végétal qui fait penser à un pigeonnier avec planche et trous d'envol.

Document No 6
Mieux que cet agrandissement de détail, une autre carte de la même époque nous fait voir de près les deux édifices dans leur morphologie et leur implantation initiales. Ils sont baptisés « Maisons de "Gardians" » par l'éditeur, alors que seul l'édifice de droite, en raison de sa cheminée, peut prétendre à cette appellation de « maison », l'autre n'étant qu'une remise. Quant à la qualification de « gardians » donnée aux habitants, elle est en contradiction avec la mention manuscrite « Les dernières cabanes de pêcheurs aux Saintes-Maries-de-la-Mer » rajoutée au dos de la carte des années 1930 (No 4a) reproduite plus haut.
Quoi qu'il en soit, cette vue rapprochée dévoile le capharnaüm qui règne sous l'auvent de l'habitation et le long du gouttereau de gauche.
L'arbre mort aux branches curieusement coupées qui est fiché dans le sol à côté de la roubine, est certainement lié à l'activité des lavandières saintines sur cette berge, là où se trouvent deux planches à lessive. Le paysan sur son attelage n'a vraisemblablement rien à voir avec l'habitation, il ne fait qu'emprunter le chemin qui longe la roubine pour aller à son champ.
Enfin, l'antenne qui se dresse dans le lointain sur la droite, est celle du « poste de télégraphie sans fil » des Saintes-Maries.
|
|
|
Carte postale du début du XXe siècle (au dos, mention « Carte Postale », en français ainsi que dans d'autres langues). |
Document No 7
Le lavoir municipal des Saintes-Maries-de-la-Mer au temps de sa splendeur. L'eau de la roubine en est toute blanchâtre. À l'arrière-plan se dessinent nos deux édifices.
|
|
|
Carte postale du début du XXe siècle. |
3 - Cabanes de pêcheurs à l'est de la Camargue
Nos recherches de cartes postales de Camargue figurant de véritables cabanes de pêcheurs n'ont rien donné. Par contre, nous avons trouvé des cartes postales de Fos-sur-Mer et de Marignane – autrement dit la région de l'Étang de Berre, à l'est de la Camargue et de la Crau – où apparaissaient d'authentiques cabanes de pêcheurs qui ne sont pas sans évoquer, dans leur morphologie, leur structure et leur détail, les cabanes végétales camarguaises mais s'en éloignent par une caractéristique tout à fait remarquable ainsi qu'on va le voir.
Document No 8
Sur cette étonnante carte postale des années 1900 figurant deux cabanes de pêcheurs à Fos-sur-Mer, la cabane au premier plan fait penser à celle tout en roseau du mas de l'Amarée (cf. Partie I), sauf que l'élévation du pignon est moindre, les versants de la toiture sont moins pentus et la saillie du chevron axial de croupe se termine en pointe et non par une croix. La concavité du faîtage est le signe d'une faîtière fatiguée.
La cabane au deuxième plan diffère quelque peu de la première : les versants de la toiture sont plus pentus et semblent descendre jusqu'au sol, le pignon est enduit extérieurement et les rives de la toiture s'avancent légèrement pour protéger le pignon du vent et de la pluie.
Dans les deux cas, le faîtage est protégé des infiltrations de l'eau de pluie par une chape de plâtre.
|
|
|
Carte postale des années 1900 (a voyagé en 1907). |
Documents Nos 9 et 10
Située en bordure de l'étang de Berre, au lieu-dit La pointe du ruisseau à Marignane, cette cabane de pêcheur possède cette caractéristique remarquable, déjà notée dans une des cabanes de Fos-sur-Mer : ses versants de toiture recouvrent les murs latéraux et descendent jusqu'au sol ou quasiment, donnant à l'édifice une section en forme d'ogive. Le vent, les intempéries, ou l'âge, ont toutefois quelque peu mité les claies des rangées inférieures. Le bas de la rangée supérieure est maintenu en place par ce qui ressemble à une perche disposée horizontalement. Un tortillon de sagne enserre la pointe de l'arbalétrier-chevron de croupe.
|
|
|
Carte postale des années 1900. |
Alors que dans la première vue la hutte semble faire le gros dos au vent qui souffle sur l'étang en ployant les tiges des roseaux et en agitant la surface de l'eau, dans la deuxième vue le vent est en panne, pas une ride ne froisse l'eau.
|
|
|
Carte postale des années 1900. |
Documents Nos 11 et 12
Les deux cartes postales qui suivent sont regroupées car elles ont pour sujet un seul et même ensemble de trois cabanes situé à Marignane. Sur la première et vraisemblablement la plus ancienne carte (« Paturage sur les bords de l'Etang »), les cabanes semblent encore en activité et en bon état, exception faite de celle du milieu dont le toit présente une brèche. Sur la deuxième carte, la plus récente (« L'Estéou – Lei Cabano dou Mestré Panon »), la cabane médiane s'est affaissée sur elle-même et les lieux semblent abandonnés, l'herbe n'a plus rien à craindre de la dent des moutons...
Un doute existe quant à la fonction de ces constructions : s'agit-il de cabanes de pêcheurs, de cabanes de chasseurs, ou ont-elle un rapport avec le berger et son troupeau en train de paître devant les cabanes ?
|
|
|
Carte postale des années 1900 (a voyagé en 1906). |
Si nos trois cabanes sont alignées côte à côte et regardent toutes du même côté, elles présentent toutefois des différences architecturales notables.
La plus intéressante des trois est sans conteste celle de droite, la plus grande, et manifestement habitable à en juger par le conduit de fumée qui saille à la verticale de l'arrière du versant gauche (et qui est relié vraisemblablement à un poêle en fonte car il faudrait un pignon en dur pour accueillir une cheminée). Mais la caractéristique la plus remarquable, c'est l'enveloppement des murs gouttereaux par les versants de toiture qui descendent jusqu'au sol, donnant au bâtiment une section en forme d'oignon et au bas de la couverture l'aspect d'une robe de danseuse de flamenco. À cela s'ajoutent l'avancée prononcée des versants par rapport au pignon, le tortillon recourbé coiffant le bout du chevron axial de croupe, les cannes fixées aux claies de couverture pour les maintenir en place (procédé également appliqué au pignon). Un écriteau, malheureusement illisible, est fixé tout en haut du pignon.
Curieusement, l'entrée de la cabane est axiale, ce qui exclut, a priori, la présence d'un poteau axial porteur. Elle est fermée par une porte en bois dont la moitié supérieure semble être protégée par un panneau mobile. Une toile accrochée au-dessus du linteau, complète le dispositif.
La cabane du milieu, légèrement en retrait, est plus petite et plus simple. Pas d'avancée des rives de la toiture au niveau des rampants. Le trou dans le versant visible laisse voir la faîtière et un chevron qui s'appuie sur elle. La porte est légèrement décalée vers la gauche, ce qui postule un poteau porteur axial. Sur la deuxième photo, l'édifice s'est effondré.
La troisième cabane est de même taille que la précédente, avec des versants de toiture enveloppants comme pour la première. L'entrée est axiale, on ne peut guère en dire plus.
|
|
|
Carte postale des années 1900. |
Document No 13
Sur cette carte postale de « La pointe du Vallat » à Marignane, on aperçoit, sous les « Mille baisers de Léontine », le côté et l'arrière des trois cabanes précédentes (du moins nous le supposons d'après l'agrandissement de détail). Celle au premier plan exhibe une vaste toiture enveloppante « en robe de danseuse de flamenco ». La médiane a un mur latéral vertical sous un versant oblique classique. Celle à l'arrière plan se devine à la pointe saillante de son chevron de croupe.
|
|
|
Carte postale des années 1900. |
|
|
|
Agrandissement de détail. |
Document No 14
Le toponyme « La pointe du ruisseau » est manifestement l'équivalent français de la légende « La pointe du Vallat » imprimée sur la vue de la carte postale précédente. Mais là n'est pas l'intérêt de cette nouvelle carte postale : il est dans la présence de la proue d'une grande et haute cabane de sagne aux versants qui descendent jusqu'au sol, caractéristique déjà notée dans d'autres cartes. Cependant, on discerne mal la disposition si particulière des rangées de roseaux se chevauchant à la façon des épaisseurs d'une robe de danseuse de flamenco. La couverture de roseau, qui semble d'un seul tenant tant les épaisseurs des rangées sont faibles, est maintenue en place par des lignes parallèles de cannes. Le faîtage est formé par la réunion des rangées de roseau de part et d'autre. On note aussi une avancée des rampants au-dessus du pignon-façade, sauf qu'il en manque un bout au niveau de la moitié supérieure du rampant le plus proche. Enfin, on entrevoit un bout de l'entrée, décalée dans la partie droite du pignon. Il est difficile d'en dire plus sur la structure de la cabane étant donnée l'angle sous lequel celle-ci a été prise par le photographe.
|
|
|
Carte postale des années 1920. |
Document No 15
Un œil averti ne peut manquer de reconnaître, sur cette carte postale colorisée des années 1900, la troisième cabane à compter de la droite du groupe de l'Estéou à Marignane (cf. Documents Nos 10 et 11) : même inflexion de la ligne de faîte, même disposition des rangées de roseau de la toiture. Si l'on avait un doute sur la destination de l'édifice, la présence de deux chasseurs et de leurs chiens ne manque pas de le lever.
Cette vue plus rapprochée de l'édifice en montre la technique rudimentaire : en particulier, le faîtage n'est pas étanche, étant obtenu par l'affrontement des claies de couverture ultimes des versants opposés.
|
|
|
Carte postale colorisée des années 1900. |
Document No 16
Enfin, encore et toujours à Marignane, une cabane à toiture « en robe de gitane dansant le flamenco », à l'élévation si caractéristique en forme d'oignon, avec entrée s'ouvrant dans la partie de droite du pignon. Ici encore on a affaire à une cabane manifestement de chasseurs de gibier d'eau.
|
|
|
Carte postale des années 1910-1920 (ton sépia). |
Document No 17
Si l'on pousse les investigations un peu plus loin à l'est, du côté de Fos-sur-Mer, on tombe sur des cartes postales de la plage de l'anse de Saint-Gervais telle qu'elle se présentait au tout début du XXe siècle. Là aussi, on découvre la toiture à croupe arrondie et le pignon droit d'une cabane de pêcheur entièrement végétale, laquelle n'est pas sans rappeler les cabanes camarguaises tout en sagne de la même époque : le bout saillant du chevron de croupe est bien reconnaissable ainsi que la chape de plâtre protégeant le faîtage. Les murs toutefois ne sont pas visibles, cachés qu'ils sont par un talus. La fonction du bâtiment ne fait aucun doute : sur la plage, un peu en avant par rapport à la cabane, se dresse un portique où pendent des filets tandis que des pêcheurs prennent la pose dans leurs barques.
|
|
|
Carte postale colorisée des années 1900. |
Document No 18
Sur une autre carte postale de la plage Saint-Gervais, antérieure de quelques années, on découvre, à l'extrême droite, la même cabane à croupe, dans sa quasi-totalité, mais aussi, à gauche, à l'emplacement de la cabane moderne en planches, la cabane à croupe qui la précédait, avec son faîtage dégarni augurant une fin prochaine.
|
|
|
Carte postale noir et blanc des années 1900. |
|
|
|
Cabane de droite (agrandissement de détail) : un placage de planches de bois disposées horizontalement protège le pignon. |
|
|
|
Cabane de gauche (agrandissement de détail): si le pignon est ici aussi protégée par des planches posées horizontalement, en revanche la pente des versants est nettement plus marquée que dans la cabane précédente et aucune chape d'enduit à la chaux ne recouvre le faîtage. |
4 - Conclusion
Le résultat de notre quête de vues anciennes de cabanes de pêcheurs en Camargue s'avère bien maigre : une cabane photographiée par l'ethnologue et photographe Carle Naudot, des maisonnettes de pêcheurs improprement baptisées « cabanes », la remise à matériel d'un pêcheur, mais il reste la bibliographie camarguaise à dépouiller (1).
Paradoxalement, la recherche de cartes postales pertinentes nous a fait découvrir l'existence autrefois de cabanes tout en roseau servant à la pêche ou à la chasse au gibier d'eau, à l'est du delta du Rhône, principalement à Marignane, au bord de l'étang de Berre, et à Fos-sur-Mer, au bord de la mer. Il convient de rappeler que les zones palustres du littoral méditerranéen depuis les Pyrénées-Orientales jusqu'aux Bouches-du-Rhône ont connu ce type de cabane.
(1) Il s'agit principalement des titres suivants :
- (de) FLANDRESY Jeanne, CHARLES-ROUX Jules, MELLIER Etienne, Le livre d'or de la Camargue, tome I, Le pays; les mas et les châteaux; le Rhône camarguais, Librairie A. Lemerre, Paris, 1916, 437 p., 11 cartes, 350 ill. dont
13 h. t. (documents photographiques de la plupart des mas de Camargue).
- GEORGE Pierre, La région du Bas-Rhône. Etude de géographie régionale, thèse pour le doctorat ès lettres, présentée à la Faculté des lettres de l'Université de Paris, J. B. Baillière et Fils, Paris, 1935, XX p. + 691 p., 103 fig., 27 pl. et 4 cartes h. t., en part. pp. 570-589 (mas et bastides de Provence, cabanes de Camargue).
- BENOIT Fernand, Les chaumières à abside de la Camargue : la cabane, origine, description, mode de construction, dans Revue du folklore français, t. 9, 1938, No 2, avril-juin, pp. 51-53, pl. h. t.
- BENOIT Fernand, Les coutumes, l'habitation et les fêtes [en Camargue], dans Le Chêne, numéro spécial, No 16, 1938, pp. 100-112.
- BENOIT Fernand, La Provence et le Comtat Venaissin, Gallimard, Paris, 5e édition, 1949, 409 p., en part. pp. 40-75 (L'habitat; maisons; matériaux; cabanon; borie-grenier; chaumière de Camargue) (réédité en 1975 sous le titre La Provence et le Comtat Venaissin. Arts et traditions populaires, chez Aubanel, Avignon, 390 p.)
À SUIVRE
Pour imprimer, passer en mode paysage
To print, use landscape mode
© CERAV
Le 15 septembre 2008 / September 15th, 2008 - Augmenté le 4 octobre 2008 - le 5 novembre 2008 - 8 décembre 2008 - 9 mai 2009 - 14 juin 2009 - 13 août 2009 - 29 avril 2012 - 17 mars 2021 - 8 mai 2021 / Augmented on October 4th, 2008 - November 5th, 2008 - December 8th, 2008 - May 9th, 2009 - June 14th, 2009 - August 13th, 2009 - April 29th, 2012 - March 17th, 2021 - May 8th, 2021
Référence à citer / To be referenced as :
Christian Lassure
L'évolution de la cabane camarguaise au XXe siècle d'après des cartes postales et photos anciennes (The evolution of the Camarguaise hut in the 20th century as shown in old postcards and photos)
V - Cabanes et maisons de pêcheurs en Camargue (Fishermen's huts and cottages in the Camargue)http://www.pierreseche.com/cabanes_de_pecheurs.htm
15 septembre 2008
I - Cabanes entièrement en roseau des années 1900
II - Le mas de l'Amarée et ses deux cabanes aux Saintes-Maries-de-la-Mer
III - Les cabanes du premier mas du Simbèu aux Saintes-Maries-de-la-Mer
IV - Les cabanes du « deuxième mas du Simbèu » aux Saintes-Maries-de-la-Mer
V - Cabanes et maisons de pêcheurs en Camargue
VI - Les « Cabanes de Cacharel » aux Saintes-Maries-de-la-Mer
IX - Van Gogh et les chaumières saintines
X - Cabanes du front de mer aux Saintes-Maries-de-la-Mer
XI - Cabanes hôtelières et maisons à la gardiane
XII - Vocabulaire architectural de la chaumière camarguaise
XIII - Les auvents dans la cabane de gardian
XIV - Les extensions de la cabane de gardian
XV - Cabanes représentées sur le plan de la Camargue de 1584